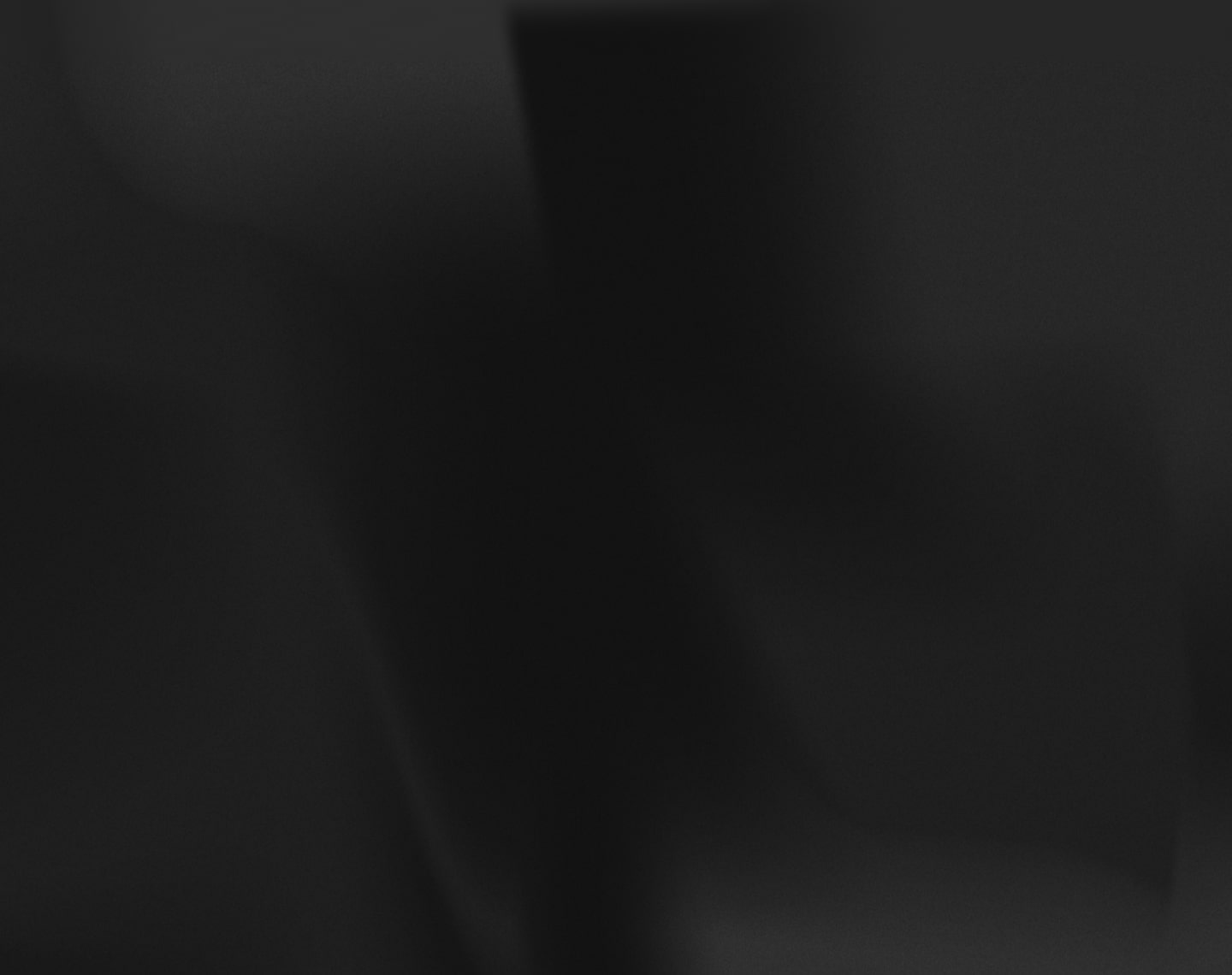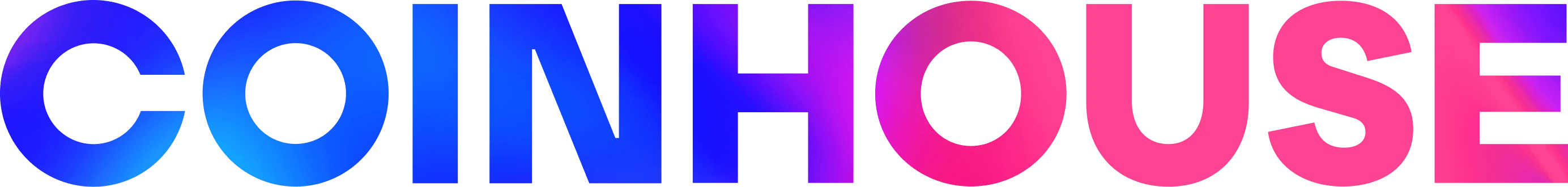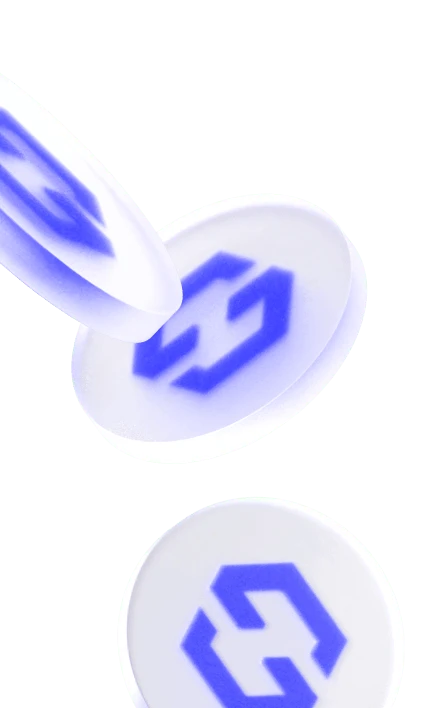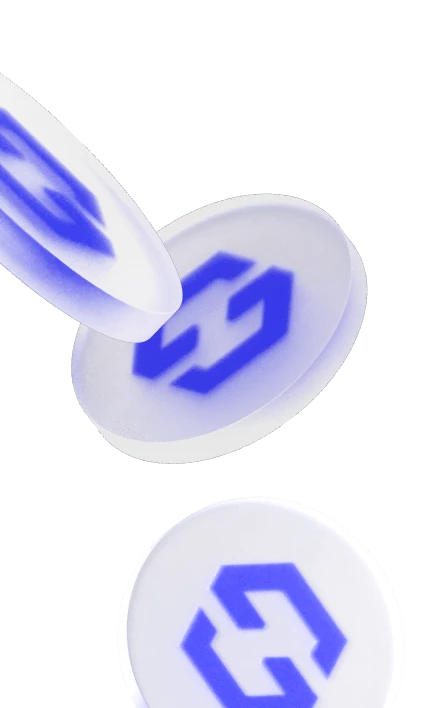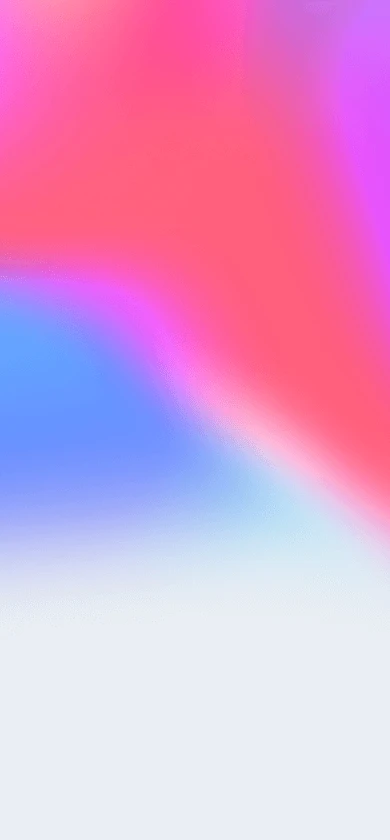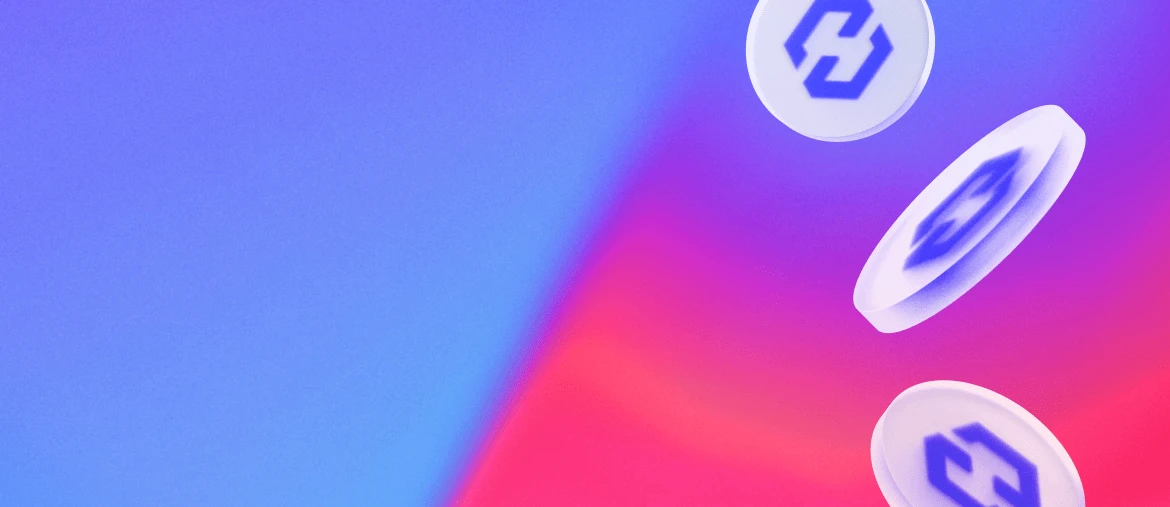La principale promesse de Solana est d’apporter un fonctionnement plus rapide et des frais de transaction moins élevés que sur la blockchain Ethereum.
En effet, avant son passage à la « preuve d’enjeu » (Proof-of-Stake) en 2022, Ethereum avait recours à la « preuve de travail » (Proof-of-Work), une méthode qui avait ses avantages, mais qui était particulièrement énergivore, et qui freinait le nombre de transactions pouvant être traitées (15 à 30 par seconde au maximum).
Cette transition d’Ethereum vers la preuve d’enjeu est censée régler ce problème, en réduisant jusqu’à 99 % la quantité d’énergie requise et en permettant jusqu’à 100 000 opérations par seconde. En tout cas, c’est l’objectif souhaité, si tout se passe bien…
En attendant, la blockchain Solana a, elle, utilisé la preuve d’enjeu pour assurer la validation des transactions, dès son origine.
Ce qui l’a rendue aussitôt plus écologique et plus rapide que les chaînes de bloc utilisant la preuve de travail, telles que Bitcoin ou Ethereum (dans sa version pré-2022).
En 2021, Solana était déjà en mesure de traiter plus de 50 000 à 60 000 transactions par seconde, le tout en prélevant des commissions minimes de seulement 0,00025 dollar par opération.
Il s’agit là d’un net avantage concurrentiel !
La monnaie native de cette blockchain est également appelée Solana et a pour ticker SOL sur les plateformes d’échanges.
Celle-ci joue par ailleurs un rôle central en matière de Proof-of-Stake, car les nœuds de validation du réseau de Solana le sécurisent en mettant en jeu des jetons SOL.
Un procédé peu gourmand en énergie.
Les validateurs de la blockchain qui sécurisent bien le réseau sont récompensés en recevant des tokens SOL additionnels.
Ceux qui tentent de tricher ou qui n’assurent pas leurs engagements les perdent.
Achetez du SOL avec Coinhouse facilement et rapidement
Solana utilise une technologie appelée Proof-of-History (PoH) qui, en théorie, aide le réseau à déterminer plus efficacement la date des transactions, et assure son évolutivité.
Il ne s’agit pas d’un mécanisme de consensus classique, mais d’une solution assez innovante prenant la forme d’une horloge cryptographique décentralisée, qui rend la plateforme plus rapide et efficace, puisque les validateurs n’ont pas besoin de communiquer entre eux pour pouvoir valider un bloc sur la blockchain.
Chaque nœud possédant sa propre horloge…
Pour y parvenir, Solana met en œuvre un algorithme, dit de Tolérance de panne byzantine pratique, abrégé pBFT (pour « practical Byzantine Fault Tolerance »), qui utilise les horloges cryptographiques des nœuds pour les aider à atteindre le consensus sans avoir à s’envoyer un vaste flot de communications.
Cet algorithme reposant sur la preuve d’histoire permet ainsi d’améliorer considérablement la vitesse des transactions.
Les nœuds se mettent d’accord sur l’ordre temporel des événements enregistrés sur la blockchain, dans le cadre d’un intervalle de temps optimal, dit le « slot time », au cours duquel un validateur va soumettre un bloc au réseau.
Dans le cas de Solana, cet intervalle est normalement de 400 millisecondes. Grâce à ce mode d’enregistrement des transactions, Solana peut facilement garder une trace des événements, et surtout de leur ordre.
Selon les développeurs de Solana, cette technologie, couplée à d’autres innovations, permet d’accélérer significativement la vitesse des transactions tout en assurant une bonne sécurité sur la blockchain.
C’est ce qui la rend capable de traiter plus de 65 000 transactions par seconde, sans passer par des réseaux de seconde couche.
Dans les blockchains basées sur la preuve d’enjeu traditionnelles, chaque nœud transmet les transactions confirmées ou rejetées uniquement en fonction de son horloge locale, et règle les divergences ultérieurement.
Ce qui peut devenir problématique lorsqu’il s’agit de parvenir à un consensus sur la validité des transactions, comme sur l’ordre dans lequel elles ont eu lieu. Mais, surtout, cela peut surtout entraîner un retard dans le délai de confirmation, voire le rejet du bloc, et donc réduire la vitesse des transactions.
Le protocole blockchain de Solana promet une préservation de nombreuses caractéristiques décentralisées tout en réglant ce souci de scalabilité.
Sa méthode de consensus recourant à la preuve d’histoire (Proof-of-History) permet d’ajouter l’élément temps au grand livre de la blockchain Solana, tout en vérifiant de manière cryptographique le passage du temps entre deux événements.
Ainsi elle fournit un ordre chronologique relatif des événements, qui ne dépend pas des horloges locales des nœuds.
Pour ce faire, un nœud du réseau est choisi comme leader et est chargé de générer une séquence de Proof-of-History (PoH).
Ce leader séquence les messages pour une efficacité et un débit maximum.
La sortie ordonnée est envoyée aux nœuds réplicateurs appelés validateurs, qui effectuent la vérification de l’algorithme de consensus.
À tout moment, il n’y a qu’un seul leader sur le réseau, qui est choisi par un système de votes.
L’architecture de Solana fait également appel à plusieurs solutions intéressantes :
- Le protocole de propagation des blocs Turbine, qui regroupe les données devant être transférées entre les nœuds en plus petits paquets, afin de mieux ménager la bande passante du réseau et d’augmenter la vitesse de traitement des transactions.
- Le moteur Sealevel qui réalise le traitement parallèle des transactions, en exploitant mieux les processeurs multicœurs. D’ailleurs, Solana est la première blockchain au monde à avoir mis en place une exécution en parallèle des contrats intelligents.
- La solution de gestion de memory pool Gulf Stream, qui réduit le nombre de transactions non confirmées, en repoussant la transmission des transactions à l’extrémité du réseau pour diminuer la charge mémoire et le temps de confirmation.